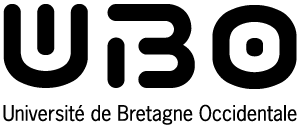The American house / la maison américaine
3-4 avril 2025 – Université Bretagne-Sud, Lorient.
Christelle Centi (UBO), Nawelle Lechevalier-Bekadar (UBS), Pauline Pilote (UBS)
HCTI (Héritage et Création dans le Texte et l’Image)
Villa, lotissement pavillonnaire, résidence secondaire, manoir, maison hantée, cabane dans les bois, la figure de la maison revient sans cesse dans la littérature, le cinéma et les séries américaines. Si l'on peine souvent à proposer une définition stable et univoque de ce qu’est le Great American Novel (souvent pointé du doigt comme une chimère critique), force est de constater que de Cooper à Danielewski, la maison américaine s’y invite comme métaphore structurante. Dans Beloved de Morrison, 124 constitue cet espace de hantise qui rappelle l’Amérique à son passé esclavagiste ; la maison aux sept pignons de Hawthorne abrite les fantômes sanglants du puritanisme ; vulgaire et sublime, la villa de Gatsby incarne tout le paradoxe d’un rêve « matériel sans être réel », quand The Mansion de Faulkner reflète, à plus large spectre, la maison divisée de l’Amérique, incapable de faire le deuil d’une guerre qui continue de fracturer le pays. Il semble que la maison, par un effet de synecdoque, serve à penser l’idée de nation. Indivisible ou au contraire fragmentée, elle fonctionne comme un miroir de l’Amérique elle-même, en tant que son destin est lié à celui des grandes sagas familiales, et permet d’envisager dans un même mouvement l’hérédité, le territoire et la propriété.
La dimension politique de la maison et de la structure sociale dont elle dépend mérite d’être envisagée dans la manière dont fiction et non-fiction s’en emparent. Qui possède la maison, et qui est exclu de la propriété ? Cette question traverse l’histoire des États-Unis depuis les débuts de la colonisation jusqu’à la crise actuelle du logement. En parallèle, on peut s’interroger sur la manière dont la location et le statut de locataire ont pu être travaillés par la littérature et la production cinématographique : quelles sont les figures de non-propriétaires, et leur rapport à la maison qu’ils ou elles occupent ? Des métayers de Grapes of Wrath de Steinbeck (et de Ford) aux habitant des motels de The Florida Project (Sean Baker), la précarité des situations décrites semble fonctionner comme ressort narratif. Elle constitue aussi un enjeu politique dans la mesure où elle engendre et nourrit des formes de marginalisation diverses au sein de la nation et de l’économie narrative, comme c’est le cas dans le livre Nomadland de Jessica Bruder et son adaptation cinématographique par Chloé Zhao. La popularité grandissante des émissions de téléréalité qui se concentrent sur la maison (Two Chicks and a Hammer, la chaîne HGTV, les émissions d’agent immobilier ou de décoration d’intérieur) traduisent une forme d’obsession pour l’acquisition, la transmission, l’aménagement et l’investissement de la maison américaine.
Construire sa demeure, l’habiter, la protéger, s’y épanouir et s’y étioler : la littérature met constamment en scène des maisons qui structurent l’espace. Dès les débuts de son histoire, la nation nord-américaine s’est fondée sur la formation d’enclaves protégées, arrachées à la wilderness, et donc soutirées aux peuples indigènes, à la nature sauvage, au diable. Ces premières maisons de pionniers, érigées de haute lutte, assoient une certaine vision de l’américanité perçue comme un agôn, celui de l’homme face à l’hostilité du monde extérieur. La maison américaine s’est donc initialement imposée comme un lieu de (r)établissement de la morale chrétienne et de la civilisation, comme une poche de résistance aux assauts d’une nature fascinante et démoniaque, et de tous ses avatars. Elle représente successivement un refuge contre les indigènes, une partie de la cité idéale sur la colline, envisagée par les écrits puritains, un symbole de la domination blanche sur les populations esclaves dans Gone with the Wind de Mitchell et Sharp Objects de Flynn, un idéal de tranquillité domestique dans les suburbs à l’écart des violences urbaines et criminelles, ou un château-fort assiégé par des figures du dérèglement qui envahissent la vie de famille, comme dans la série télévisée Criminal Minds.
Domaine par excellence de l’intimité, la maison se trouve au cœur des histoires et des crises familiales ou collectives. Progressivement, on comprend que ce qui menace ce lieu n’est pas tant extérieur qu’intérieur : les ennemis réels et métaphoriques, individuels et communs, reviennent et la hantent dès la publication de « The Fall of the House of Usher » de Poe, des soubassements (dans ‘Salem’s Lot de King et Get Out de Jordan Peele) jusqu’au grenier dans Hereditary, réalisé par Ari Aster.
Métaphores de l’esprit (avec la conceptualisation progressive de l’inconscient et de l’architecture de la psyché), ces maisons proposent autant de cadres autoréflexifs jetant un éclairage particulier sur la psyché des personnages (« The Yellow Wallpaper » de Gilman) ou sur une certaine vision de la littérature (Henry James ne parle-t-il pas d’une « house of fiction » qui possèderait un million de fenêtres ?). Faulkner, quant à lui, apparente le métier d’écrivain à celui de charpentier, permettant dès lors une approche spatiale du texte comme une architecture faite de surfaces, de poutres et de cloisons. Dès lors qu’on se concentre sur la structure littérale de la maison, qu’incarnent le salon, la chambre parentale, le sous-sol, le grenier, le garage, la cuisine ou encore le débarras ? Et comment ne pas être happé par le pouvoir symbolique du seuil, de la façade et des ouvertures ?